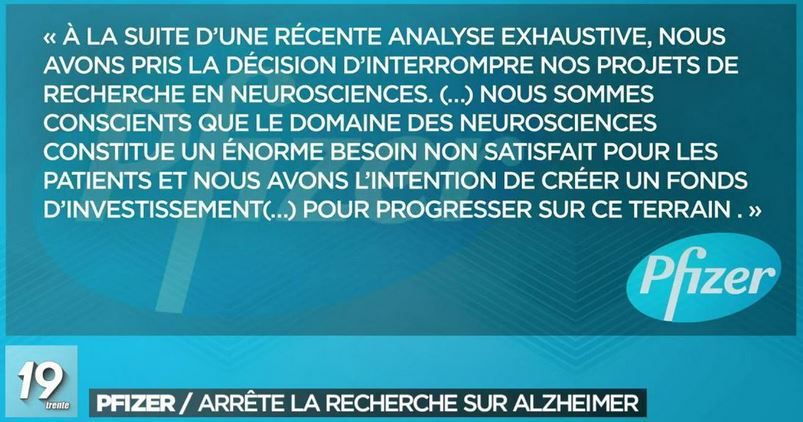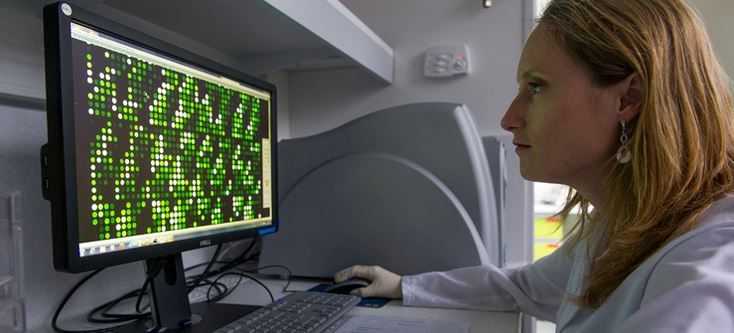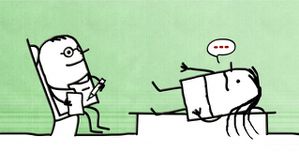Résumé
Dans un texte incisif récemment publié dans le « British Medical Journal », quatre spécialistes des domaines de la gériatrie, de l’épidémiologie et de la santé publique (Le Couteur, Doust, Creasey, & Brayne, 2013) ont clairement mis en question les politiques publiques incitant à dépister les états de « pré-démence », en indiquant en quoi ces incitations ne reposaient pas sur des données empiriques probantes et ignoraient les méfaits pouvant y être associés.
Les auteurs montrent notamment en quoi on est passé d’une conception selon laquelle les personnes âgées manifestant des difficultés cognitives légères étaient considérées comme ayant des problèmes bénins et liés à l’âge à une conception selon laquelle ces personnes ont, ou progresseront inévitablement vers, une « maladie ». Dans la ligne de ce que nous avons fréquemment mentionné dans notre blog, ils mettent également en avant les différents problèmes liés à l’expansion des consultations-mémoire, à l’adoption du concept catégoriel de « MCI » (« Mild Cognitive Impairment » ou Trouble Cognitif Léger), ainsi qu’à l’utilisation des biomarqueurs et de la neuroimagerie à des fins de diagnostic précoce de la « maladie d’Alzheimer préclinique » (asymptomatique).
Par ailleurs, ils indiquent en quoi le recours au concept de « MCI » ou aux biomarqueurs ne peut se justifier en invoquant la possibilité offerte aux personnes âgées de planifier leur futur en connaissance de cause, ni en considérant les bénéfices que pourraient tirer ces personnes d’un traitement.
Enfin, ils relèvent les risques, effets négatifs et coûts financiers du dépistage et diagnostic précoces, les intérêts économiques et commerciaux considérables qui y sont associés et aussi le fait que les ressources qui y sont consacrées sont autant de ressources qui ne seront pas disponibles pour l’amélioration des soins et de la qualité de vie des personnes présentant une « démence » avancée.
Introduction
Nous avons maintes fois indiqué en quoi l’adoption du concept de « Mild Cognitive Impairment » (MCI ; « Trouble Cognitif Léger ») ainsi que l’utilisation des biomarqueurs, dans le cadre d’une démarche de diagnostic précoce de la « démence », conduisaient à une pathologisation croissante et illégitime du vieillissement, avec toutes les conséquences négatives qui peuvent y être associées : stigmatisation, anxiété/dépression/honte, modification dans les relations familiales, isolement social, déclassement professionnel, difficultés auprès des assureurs, consommation accrue de médicaments, etc. (voir nos chroniques « Le trouble cognitif léger (ou MCI): une flagrante myopie intellectuelle » ; « La pathologisation du vieillissement cognitif est en marche ! » ; « Pour en finir avec le diagnostic catégoriel de MCI » ; « L’empire Alzheimer ne désarme pas !).
Dans un texte incisif récemment publié dans le « British Medical Journal » (Le Couteur, Doust, Creasey, & Brayne, 2013), quatre spécialistes des domaines de la gériatrie, de l’épidémiologie et de la santé publique ont clairement mis en question les politiques publiques incitant à dépister les états de « pré-démence », en indiquant en quoi ces incitations ne reposaient pas sur des données empiriques probantes et ignoraient les méfaits pouvant y être associés. Il nous est apparu utile de présenter de façon détaillée les arguments contenus dans ce texte au titre ô combien explicite : « Too much medicine. Political drive to screen for pre-dementia: not evidence based and ignores the harms of diagnosis ». Dans certains cas, nous renforcerons l’argumentation des auteurs en renvoyant à des études récentes, non mentionnées dans leur texte, et nous décrirons également de façon plus détaillée l’une ou l’autre des recherches identifiées dans leur article.
Les auteurs partent du constat que des politiques gouvernementales récentes ont appelé au dépistage systématique de la démence et du « MCI ». Ainsi, aux Etats-Unis, dans le cadre d’une loi qui a réformé les soins de santé, l’assurance Medicare couvrira une visite annuelle de « bien-être » chez un médecin, incluant la détection d’un trouble cognitif ou de tout changement mesurable dans les capacités cognitives. En Angleterre, le gouvernement a annoncé qu’il récompenserait les médecins généralistes (d’environ 4200 Euros par an et par cabinet) pour évaluer les personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi que celles de plus de 60 ans appartenant à des groupes à risque (celles ayant une maladie vasculaire établie ou un diabète).
Le gouvernement anglais s’est également engagé à ce qu’il y ait une consultation-mémoire dans chaque ville de moyenne à grande importance, notamment pour accroître le diagnostic précoce. Et pourtant, comme le signalent Le Couteur et ses collègues, il n’existe pas de données solides indiquant que le recours aux consultations-mémoire ait des effets bénéfiques. Quand elles furent introduites durant les années 1980, leur but principal était de recruter des patients pour entrer dans des essais cliniques sur les inhibiteurs de la cholinestérase. Elles furent ensuite utilisées pour accroître la consommation de ces produits, lesquels ont fait l’objet d’une intense promotion indiquant qu’ils constituaient un traitement puissant et efficace et ce, en dépit de l’absence de données convaincantes appuyant leur utilisation.
Dans ce contexte, peu d’attention a été prêtée au fait que se rendre dans une consultation-mémoire génère du stress pour les personnes âgées et leurs proches et contribue à accroître l’utilisation des biomarqueurs et de la neuroimagerie. Bien que certains défendent l’utilité des consultations-mémoire, un essai randomisé contrôlé mené aux Pays-Bas par Meeuwsen et al. (2012) a montré que ces consultations n’étaient pas plus efficaces que les soins standards prodigués par les médecins généralistes. Plus spécifiquement, les auteurs ont comparé des personnes ayant reçu un diagnostic de « démence » légère et modérée (ainsi que leur proche) qui étaient suivies, soit dans une consultation-mémoire, soit par le médecin généraliste. Après un suivi de 12 mois, les résultats ne permettaient pas de conclure à une efficacité plus importante des consultations-mémoire concernant la qualité de vie des personnes avec une « démence ». Le suivi par les généralistes semble même avoir un petit effet bénéfique sur l’anxiété et l’état d’humeur des proches aidants (voir également notre chronique « Une autre façon d’organiser les cliniques de la mémoire ? »).
Un changement de terminologie traduisant un changement d’approche
La focalisation sur le diagnostic précoce, et en particulier sur l’identification du « Trouble Cognitif Léger (MCI) », découle du postulat selon lequel les personnes présentant une « démence » ont une « maladie » qui progresse durant une période où les symptômes sont initialement légers et où un traitement serait plus efficace.
Historiquement, les personnes âgées manifestant des difficultés mnésiques ou cognitives légères étaient considérées comme ayant des problèmes bénins et liés à l’âge. Comme le mentionnent Le Couteur et al., on parlait ainsi de « Benign senescent forgetfulness », « Age-associated memory impairment », « Late life forgetfulness », « Age consistent memory impairement » ou de « Age associated cognitive decline ». Cependant, ces 15/20 dernières années, un changement de terminologie et de conceptualisation a conduit à considérer que ces personnes avaient une maladie ou un état qui progresserait inévitablement vers une « maladie démentielle ». Ainsi, ont été utilisés les concepts de « Mild cognitive impairment », « Cognitive impairement no dementia », « Prodromal Alzheimer’s disease », « Pre-clinical Alzheimer’s disease » et, dans le nouveau DSM-5, de « Minor neurocognitive disorder ».
Ces changements terminologiques vont ainsi conduire à un sur-diagnostic, puisqu’ils permettent de considérer des personnes asymptomatiques comme ayant une « maladie d’Alzheimer » ou une « démence » pré-symptomatique.
Mise en question de la validité prédictive du « MCI »
Il faut rappeler que seuls 5 à 10 % des personnes ayant reçu un diagnostic de « Trouble Cognitif Léger (MCI) » progresseront annuellement vers une « démence » et que 40 à 70% de ces personnes n’évolueront pas vers une « démence » ou verront même leur fonctionnement cognitif s’améliorer (voir nos chroniques « Le trouble cognitif léger : une flagrante myopie intellectuelle » et « Pour en finir avec le diagnostic catégoriel de MCI »). Dans une étude récente ayant suivi pendant 2 ans des personnes qui avaient reçu un diagnostic de « MCI » et de « maladie d’Alzheimer », Song et al. (2013) ont confirmé l’existence d’une amélioration du fonctionnement cognitif chez certaines personnes avec, en parallèle, une amélioration au plan des atteintes cérébrales. Il est intéressant de relever qu’aucune des personnes « MCI » chez qui une amélioration cérébrale a été observée n’a présenté de « démence » durant le suivi de 24 mois.
Il existe également des données indiquant que beaucoup de personnes ayant développé une « démence » n’ont pas, préalablement, manifesté les critères de « MCI ». En outre, il a été observé que le développement d’une « démence » était plus élevé chez les personnes qui n’avaient pas les symptômes de « MCI » que chez celles que les présentaient (Stephan et al., 2008).
Notons que l’utilisation de tests cognitifs dans le contexte d’un diagnostic de « MCI » (voire de « démence ») peut conduire à des erreurs fréquentes de diagnostic. Rappelons que, pour correspondre au diagnostic de « MCI », les scores aux tests cognitifs doivent se situer à 1 ou 1.5 écart-type (ET) en dessous de la moyenne des performances de personnes appariées en âge et niveau scolaire. Dans ce contexte, il faut relever qu’il est fréquent d’observer une performance faible à un test cognitif chez des personnes normales, et ce d’autant plus qu’on leur administre un plus grand nombre de tests. Ainsi, par exemple, Brooks, Iverson, Holdnack et Feldman (2008) ont observé que, dans un échantillon de personnes âgées de 55 à 87 ans (issues de l’échantillon utilisé pour l’étalonnage de l’Echelle de Wechsler Mémoire, WMS-III), 26% des personnes obtenaient un ou plusieurs scores de mémoire (parmi les 8 scores examinés) égaux ou inférieurs au centile 5 (c’est-à-dire -1.5 ET). Quand les scores étaient ajustés selon les caractéristiques démographiques (genre, ethnicité, éducation), 39% des personnes obtenaient un score égal ou inférieur au centile 5. Les raisons sous-jacentes à cette variabilité sont bien sûr nombreuses : les erreurs de mesure, la présence de faiblesses éducatives anciennes dans certains domaines, une fluctuation dans la motivation, la fatigue ou l’inattention, l’anxiété et les inquiétudes (et les tentatives de les supprimer), le stress, la dépression et les ruminations, les troubles du sommeil, les médicaments, les croyances et stéréotypes négatifs sur le fonctionnement cognitif lié à l’âge, etc. (voir notre chronique « Les stéréotypes négatifs concernant le vieillissement et les attentes relatives aux déficits cognitifs liés à l’âge : une source dramatique d’erreurs diagnostiques »).
S’’interrogeant plus avant sur les conséquences de l’encouragement à un diagnostic plus répandu et plus précoce de la « démence », Le Couteur et al. (2013) mentionnent une méta-analyse menée par Mitchell, Meader et Pentzek (2011) qui a examiné la capacité des médecins généralistes de reconnaître des difficultés cognitives (allant du « MCI » à la « démence sévère ») en utilisant leur jugement clinique dans la pratique courante. Cette étude révèle que si un(e) clinicien(ne) voit consécutivement 100 personnes issues de la communauté (en estimant la prévalence de la « démence à 6 %), il/elle identifiera (sur base des critères actuels) correctement 4 cas sur les 6 ayant une « démence », mais identifiera incorrectement la « démence » chez 23 autres personnes !
L’utilisation de la neuroimagerie et des biomarqueurs à des fins de diagnostic précoce
Dans la mesure où les méthodes cliniques ne peuvent pas détecter de façon fiable les personnes qui vont développer une « démence », il a été suggéré d’utiliser, à des fins diagnostiques, l’analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR) et les techniques de neuroimagerie afin de détecter les dépôts de substance amyloïde et un niveau élevé de protéine tau dans le liquide céphalo-rachidien, ainsi que les atteintes cérébrales (atrophie et hypométabolisme dans les régions cérébrales considérées comme typiques de la « maladie d’Alzheimer » ). Dans ce contexte, les personnes avec des symptômes de « démence » et des biomarqueurs positifs (une positivité amyloïde, un niveau élevé de tau et des signes d’atteintes cérébrales caractéristiques) seraient considérés comme ayant une « maladie d’Alzheimer » prouvée, alors que les personnes asymptomatiques (sans problèmes cognitifs) présentant des biomarqueurs positifs auraient une « maladie d’Alzheimer préclinique » (pour une présentation détaillée et critique de ces propositions, voir notre chronique « L’empire Alzheimer ne désarme pas »).
Il faut tout d’abord relever qu’environ 65% des personnes âgées de plus de 80 ans ont une positivité amyloïde (révélée par l’imagerie) et pourraient donc être diagnostiquées comme ayant une « maladie d’Alzheimer » ou une « pré-maladie d’Alzheimer ». De plus, au plan neuropathologique, la plupart des personnes âgées ayant reçu un diagnostic de « maladie d’Alzheimer » présentent, outre des plaques séniles (plaques amyloïdes) et des dégénérescences neurofibrillaires, d’autres types de changements neuropathologiques, notamment des atteintes vasculaires de différents types. Il apparaît dès lors que différents mécanismes sont très vraisemblablement impliqués dans cet état étiqueté de « maladie d’Alzleimer » (voir, p. ex., notre chronique « Le vieillissement cérébral/cognitif problématique est associé à de multiples anomalies neuropathologiques »).
Ces données ont fait dire à Richards et Brayne (2010) que : « Dans sa forme la plus fréquente, à survenue tardive, le terme de maladie d’Alzheimer ne renvoie vraisemblablement pas à une entité neuropathologique discrète, mais à un syndrome clinique diffus qui représente l’accumulation de pathologies multiples résultant de facteurs de risque tout au long de la vie » (voir notre chronique « Quand d’autres voix s’élèvent pour mettre en question le concept de maladie d’Alzheimer »). Notons également que, chez les personnes au-delà de 85 ans, la prévalence de la pathologie de type « Alzheimer » (plaques amyloïdes et dégénérescences neurofibrillaires) devient similaire, que les personnes aient ou non les caractéristiques de la « démence ».
Des données récentes ont aussi mis en évidence la prévalence importante des atteintes vasculaires chez les personnes âgées présentant des « troubles cognitifs légers ». Ainsi, Stephan et al (2012) ont exploré les profils neuropathologiques (plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires, atrophie corticale et hippocampique, pathologies vasculaires) de personnes âgées issues de la communauté et décédées sans « démence », avec trois niveaux différents de capacités cognitives (établis sur base du MMSE) : pas de difficultés cognitives, difficultés cognitives légères et difficultés cognitives modérées. Cette étude a tout d’abord montré que des changements neuropathologiques étaient présents, en l’absence de « démence », chez la plupart des personnes des trois groupes (y compris, donc, chez celles qui n’avaient pas de difficultés cognitives). Les auteurs ont également observé que les personnes âgées « non démentes » présentant des difficultés cognitives légères avaient un risque accru de pathologies vasculaires (incluant des lacunes et une maladie des petits vaisseaux), mais pas de pathologie dite « Alzheimer » (plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires). De plus, ils ont constaté que la présence de problèmes cognitifs plus importants (problèmes cognitifs modérés) était associée à un pattern de changements pathologiques plus étendu, incluant des plaques séniles et des dégénérescences neurofibrillaires, de l’atrophie corticale et hippocampique, ainsi que des pathologies vasculaires (maladie des petits vaisseaux, lacunes et infarctus).
Plus récemment, Marchant et al. (2013) ont, eux aussi, constaté la prévalence élevée de pathologies cérébrovasculaires (infarctus et hyperintensités de la substance blanche) chez les personnes ayant reçu un diagnostic de « MCI », ces pathologies affectant tous les domaines cognitifs évalués (fonctions exécutives, mémoire verbale, mémoire non verbale). Par ailleurs, la présence de bêta-amyloïde (identifiée par imagerie cérébrale : « PiB positivity ») ne constituait pas un prédicteur significatif de la cognition et n’interagissait pas avec les atteintes vasculaires.
En outre, une étude récente réalisée par Knopman et al. (2013) a mis en question les critères de la « maladie d’Alzheimer préclinique » (une étude précédemment décrite dans notre chronique « Une mise en question des critères de la maladie d’Alzheimer préclinique »). Les auteurs ont comparé des personnes âgées cognitivement normales (asymptomatiques), mais ayant une positivité amyloïde et des signes d’atteintes neuronales (personnes considérées comme ayant une « maladie d’Alzheimer préclinique ») et des personnes également asymptomatiques, avec des atteintes neuronales, mais sans positivité amyloïde (personnes considérées comme ayant une pathologie non-Alzheimer ou SNAP : « Suspected Non-AD Pathology ».) En considérant que les personnes du groupe « maladie d’Alzheimer préclinique » devaient présenter des caractéristiques spécifiques, et dans la mesure où les processus physiopathologiques non-Alzheimer les plus fréquents sont les troubles cérébrovasculaires et l’alpha-synucléinopathie (accumulation d’alpha-synucléine s’agrégeant pour former des corps de Lewy), les auteurs s’attendaient à observer des différences entre les deux groupes, en particulier sur les mesures de ces deux dimensions physiopathologiques (atteintes vasculaires et alpha-synucléinopathies). En fait, aucune différence n’a été observée entre les personnes du groupe SNAP et les personnes du groupe « maladie d’Alzheimer préclinique » sur les mesures de biomarqueurs en neuroimagerie (volume hippocampique, métabolisme cérébral dans les régions censées signer la maladie d’Alzheimer, volumétrie corticale et métabolisme régional du glucose pour toutes les régions corticales), sur les marqueurs cérébraux d’atteintes cérébrovasculaires, sur les facteurs de risque vasculaires (tabagisme, diabète et hypertension) et sur les caractéristiques cérébrales et cliniques des alpha-synucléinopathies.
Comme l’a relevé Chételat (2013), ces résultats contredisent le modèle selon lequel la substance β-amyloïde initierait la séquence (la cascade) de processus pathologiques de la « maladie d’Alzheimer ». Plus fondamentalement, Chételat considère que nous entrons dans une ère nouvelle, dans laquelle la conception unitaire de la maladie d’Alzheimer en tant que maladie, caractérisée par une trajectoire pathologique unique et spécifique, est progressivement remplacée par une vision plus complexe qui considère la maladie d’Alzheimer comme une pathologie plurifactorielle, sous-tendue par plusieurs processus pathologiques partiellement indépendants, interagissant les uns avec les autres selon des organisations séquentielles variées et subissant l’influence de divers facteurs de risque à la fois communs et spécifiques. Chételat envisage donc la contribution d’autres mécanismes pathologiques que les pathologies tau et amyloïde, en particulier les atteintes vasculaires, la neuroinflammation, des anomalies de connectivité/activité neuronale, etc.
Dans cette perspective, Wirz et al. (2013) ont réalisé une revue de question révélant que de très nombreux processus, liés à l’âge, sont impliqués précocement dans le développement de la condition appelée « maladie d’Alzheimer : dysfonctionnement du signalement de l’insuline, dysfonctionnement des membranes associées aux mitochondries, changements cérébro-vasculaires, stress oxydatif et formation de radicaux libres, lésions de l’ADN, perturbation du métabolisme énergétique et dysfonctionnement synaptique.
Ainsi, ces différentes données suggèrent qu’il faut s’affranchir d’une approche réductionniste basée sur l’exploration de cascades moléculaires. Il ne s’agit pas de contester l’intérêt qu’il y a à étudier la validité prédictive de certains marqueurs biologiques concernant le vieillissement cérébral/cognitif problématique. Cependant, ces biomarqueurs devraient être considérés comme étant le reflet de certains mécanismes généraux, au sein d’un ensemble complexe de mécanismes en interaction pouvant se présenter de façon variable et dans des combinaisons également variables chez des personnes âgées présentant des difficultés cognitives plus ou moins importantes.
De plus, comme l’indiquent Brayne et Davis (2012), la conception selon laquelle les processus physiopathologiques de la « maladie d’Alzheimer » seraient clairement distincts de ceux impliqués dans le vieillissement semble de plus en plus contestable. Cette conception découlerait de la tendance à réifier les entités diagnostiques (c’est-à-dire, à les considérer comme des entités concrètes, stables), de postulats réducteurs concernant les facteurs étiologiques et du fait que peu d’études longitudinales ont été menées sur des échantillons représentatifs de la population réelle (la plupart des études ayant été menées sur des volontaires, sur des personnes recrutées dans des cliniques de mémoire et sur des personnes âgées de moins de 85 ans, ce qui limite considérablement la généralisation des résultats obtenus).
Actuellement, comme le relèvent Le Couteur et al. (2013), il n’existe pas d’étude menée sur une vaste population ayant montré que l’association entre des marqueurs biologiques et la « démence » (ou les anomalies neuropathologiques sous-jacentes) est suffisamment robuste pour justifier leurs utilisation dans la pratique clinique. En dépit de ce manque de données, les biomarqueurs et examens de neuroimagerie focalisés sur la substance amyloïde commencent à pénétrer la pratique courante, notamment dans les consultations-mémoire. Ainsi, après avoir été utilisées afin de recruter des personnes pour des essais pharmaceutiques, puis pour accroître la prescription de médicaments « anti-Alzheimer » dont l’efficacité est très loin d’être avérée, les consultations-mémoire vont principalement servir, voire servent dès à présent, à établir un diagnostic précoce en se fondant sur des concepts comme le « MCI » ou la « maladie d’Alzheimer préclinique » et certains biomarqueurs dont la validité prédictive est très contestable.
Risques, méfaits et coûts de diagnostic précoce
Au vu du caractère tellement incertain des informations qu’ils fournissent quant à la prédiction d’un déclin cognitif et son évolution, le recours au concept de « MCI » et aux biomarqueurs à des fins de diagnostic précoce ne peut pas être réellement justifié en invoquant la possibilité offerte aux personnes âgées de planifier leur futur en connaissance de cause.
Le diagnostic précoce ne peut pas non plus être justifié en considérant les bénéfices que pourraient tirer les personnes d’un traitement pharmacologique ou d’une intervention cognitive. En effet, dans la mesure où les difficultés cognitives et les atteintes neuronales des personnes âgées paraissent dépendre de multiples facteurs et mécanismes, il est illusoire de penser qu’un traitement efficace spécifique (pharmacologique ou cognitif) peut être identifié sur base de ces catégories diagnostiques. Il n’existe d’ailleurs aucun médicament qui entrave la progression de la « démence » ou qui soit efficace chez les personnes ayant reçu un diagnostic de « MCI » (voir notre chronique « Les médicaments anti-Alzheimer et les emboles cérébraux sont associés à un déclin plus rapide chez les personnes avec une maladie d’Alzheimer »). Récemment, Tricco et al. (2013) ont confirmé, via une revue systématique et une méta-analyse, que les inhibiteurs de la cholinestérase (donézépil, rivastigmine et galantamine), ainsi que la mémantine n’amélioraient pas les capacités cognitives et l’état fonctionnel des personnes ayant reçu un diagnostic de « MCI ».
Par ailleurs, il n’y a pas actuellement de données solides indiquant qu’un entraînement cognitif puisse réduire l’incidence de troubles cognitifs chez des personnes cognitivement normales ou le développement d’une « démence » chez des personnes ayant reçu un diagnostic de « MCI » (voir, p. ex., Gates, Sachdev, Fiatarone Singh, & Valenzuela, 2011).
Relevons enfin qu’il n’est nul besoin de disposer d’un diagnostic de « MCI » ou des informations fournies par d’éventuels marqueurs biologiques pour encourager la mise en place de mesures de prévention (en lien avec les facteurs de risque vasculaires, l’activité physique, l’engagement social, les activités cognitives stimulantes, la réduction du stress, l’influence des stéréotypes, etc.) visant à différer et/ou atténuer les manifestations problématiques du vieillissement cérébral/cognitif.
Outre le fait qu'il n'apporte pas d'effets bénéfiques, le recours (de plus en plus important) aux inhibiteurs de la cholinestérase et à d’autres substances chez les personnes « MCI » peut induire divers effets nocifs (tels que des problèmes gastro-intestinaux et cardiaques ; voir Tricco et al. 2013) et est associé à des coûts financiers importants. Il en va de même pour les explorations de diagnostic précoce qui sont, elles aussi, coûteuses financièrement et source possible de souffrance psychologique et de stigmatisation.
De plus, comme le mentionnent Le Couteur et al. (2013), pour beaucoup de personnes âgées avec de multiples comorbidités, la « démence » fait partie intégrante de la fin de vie et les mesures de prévention s’avèrent alors non pertinentes. A 90 ans ou plus, le risque d’être « dément » est de 60% (Brayne, Gao, Dewey, & Matthews, 2006). Dans cette perspective, la focalisation sur le diagnostic précoce de la « maladie d’Alzheimer » conduit à détourner l’attention et les ressources des besoins actuels des personnes âgées, en lien avec la qualité de vie, les comorbidités et les soins palliatifs.
Intérêts économiques et commerciaux du dépistage précoce
L’expansion du diagnostic précoce accroît les bénéfices des entreprises et sociétés impliquées dans le développement de tests de dépistage et de diagnostic précoce, ainsi que de médicaments (et substances complémentaires) commercialisés pour maintenir le fonctionnement cognitif des personnes âgées. Elle fournit également du travail aux cliniciens spécialisés dans la « démence » (il suffit de considérer le nombre de consultations mémoire qui ont été mises en place ces dernières décennies).
Le Couteur et al (2013) relatent ainsi que des firmes pharmaceutiques ont sponsorisé une étude qui demandait au gouvernement anglais de fournir une récompense financière dans le but d’accroître les taux de diagnostics, ont financé le développement et la distribution du « Seven Minute Screen for dementia » et ont la licence du Florbetapir F 18, un composant radio-pharmacologique utilisé dans la TEP amyloïde visant à détecter les plaques amyloïdes. Enfin, les auteurs rapportent que de nombreux médecins généralistes au Royaume-Uni utilisent une application pour tablette comportant une version abrégée de tests neuropsychologiques validés dans le contexte de soins de santé secondaire. Cette version n’a cependant pas été validée dans un contexte de soins de santé primaire et il n’y a eu aucune étude translationnelle visant à examiner les conséquences d’un tel testing.
Conclusions
Le Couteur et al. concluent leur article en indiquant en quoi le désir des politiciens, des associations, des universitaires et des cliniciens d’accroître la visibilité de la « démence » est compréhensible, mais que nous risquons ainsi d’être incorporés dans une « guerre contre la démence » que nous ne souhaitons pas.
En fait, il apparaît qu’environ la moitié des personnes qui ont des résultats positifs à un dépistage de troubles cognitifs refuse une évaluation diagnostique subséquente, du fait d’inquiétudes concernant les méfaits associés à ce diagnostic, tels que : la perte d’une couverture d’assurance, d’un permis de conduire ou d’un emploi, l’anxiété et la dépression, la stigmatisation et les effets sur les finances et les relations familiales (Justiss et al., 2009).
Par ailleurs, des médecins généralistes anglais ont ouvertement manifesté leur opposition au dépistage et au sur-diagnostic (Brunet et al., 2012). En outre, le dépistage de la « démence » et du « MCI » n’est pas recommandé par le « UK National Screening Committee », les directives du « Royal Australian College of General Practitioners » et la « US Preventative Services Task Force ».
Le Couteur et al. considèrent enfin que les efforts politiques visant à accroître le nombre de personnes qui reçoivent un diagnostic de « démence » et de « démence précoce » devraient plutôt être consacrés à la prévention, et notamment à réduire le tabagisme et l’obésité, deux facteurs dont on sait que leur présence durant la cinquantaine est associée à un risque accru de « démence ». Ils rappellent également que les ressources qui sont allouées au diagnostic précoce sont autant de ressources qui ne seront pas disponibles pour l’amélioration, grandement nécessaire, des soins et de la qualité de vie des personnes présentant une « démence » avancée.

®123RF Stock Photo
Brayne, C., & Davis, D. (2012). Making Alzheimer’s and dementia research fit for populations. Lancet, 380, 1441-1443.
Brayne, C., Gao, L., Dewey, M., & Matthews, F.E. (2006). Dementia before death in ageing societies - the promise of prevention and the reality. PLoS Medecine, 3:e397.
Brooks, B.L., Iverson, G.L., Holdnack, J.A., & Feldman, H.H. (2008). Potential for misclassification of mild cognitive impairment: A study of memory scores on the Wechsler Memory scale-III in healthy older adults. Journal of the International Neuropsychological Society, 14, 463-478.
Brunet, M. D., McCartney, M., Heath, I., Tomlinson, J., Gordon, P., Cosgrove, J., et al. (2012). There is no evidence base for proposed dementia screening. British Medical Journal, 345 :e3086.
Chételat, G. (2013). Aβ-independent processes: Rethinking preclinical AD. Nature Reviews/Neurology, 9, 123-124.
Gates, N. J., Sachdev, P. S., Fiatarone, Singh, M. A., & Valenzuela, M. (2011). Cognitive and memory training in adults at risk of dementia: A systematic review. BMC Geriatrics, 11:55.
Justiss, M.D., Boustani, M., Fox, C., Katona, C. Perkins, A.J., Healey, P. J., …Scott,E.. (2009). Patients’ attitudes of dementia screening across the Atlantic. International Journal of Geriatric Psychiatry, 24, 632-637.
Knopman, D.S., Jack, C.R., Wiste, H.J., Weigand, S.D., Vemuri, P., Lowe, V.J., …Petersen, R.C. (2013). Neuronal injury are not dependent on β-amyloid in normal elderly. Annals of Neurology, 73, 472-480.
Le Couteur, D. G., Doust, J., Creasey, H., & Brayne, C. (2013). Too much medicine. Political drive to screen for pre-dementia: not evidence based and ignores the harms of diagnosis. British Medical Journal, 347 :f5125 doi:10.113/bmj.f5125 (published 9 September 2013).
Marchant, N., Reed, B.R., Sanossian, N., Madison, C.M., Kriger, S., Dhada, R., ... Jagust, W.J. (2013). The aging brain and cognition. Contribution of vascular injury and Aß to mild cognitive dysfunction. Journal of the American Medical Association, 70(4), 488-495.
Meeuwsen, E. J., Melis, R. J. F., Van der Aa, G., Golüke-Willemse, G., De Leest, B., Van Raak, F.H., …Olde Rikkert, M. (2012). Effectiveness of dementia follow-up care by memory clinics or general practitioners: randomised controlled trial. British Medical Journal, 344:e3086.
Mitchell, A., J., Meader, N., & Pentzek, M. (2011). Clinical recognition of dementia and cognitive impairment in primary care: a meta-analysis of physician accuracy. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 165-183.
Richards, M., & Brayne, C. (2010). Alzheimer’s disease: What do we mean by Alzheimer’s disease? British Medical Journal, 341:c4670.
Song, X., Mitnitski, A., Zhang, N., Chen, W., Rockwood, K., for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (2013). Dynamics of brain structure and cognitive function in the Alzheimer’s disease neuroimaging initiative. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Neuropsychiatry, 84, 71-78.
Stephan, B.C., Brayne, C., McKeith, I.G., Bond, J., & Matthews, F.E.(2008). Mild cognitive impairment in the older population: who is missed and does it matter? International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 863-871.
Stephan, B.C.M., Matthews, F.E., Ma, B., Muniz, G., Hunter, S., Davis, D., …Brayne, C. and The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Neuropathology Study (2012). Alzheimer and vascular neuropathological changes associated with different cognitive states in a non-demented sample. Journal of Alzheimer’s Disease, 29, 309-318.
Tricco, A., C., Soobiah, S., Beliner, S., Ho, J. M., Ng, C., H., Ashoor, H. M., …Straus, S. E. (2013). Efficacy and safety of cognitive enhancers for patients with mild cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. Canadian Medical Association Journal, sous presse.
Wirz, K. T. S., Keitel, S., Swaab, D. F., Verhaagen, J., & Bossers, K. (2013). Early molecular changes in Alzheimer’s disease: Can we catch the disease in its presymptomatic phase? Journal of Alzheimer’s Disease, sous presse.